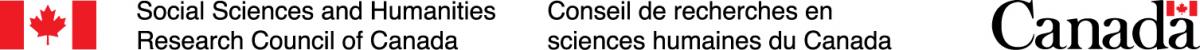Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH ! #2
Le 27 février dernier l’équipe d’Osons le DIH ! proposait un éclairage sur les affrontements en cours en Ukraine. Compte tenu de l’évolution actuelle du conflit et des nouvelles questions juridiques qui se posent, Julia Grignon et son équipe (qui accueille de nouveaux protagonistes dans cette note, en raison de leurs spécialités respectives) réitèrent et proposent une analyse de certains des nouveaux éléments qui ont été rapportés dans les médias et qui interrogent le droit international humanitaire. Parmi ceux-ci, la pratique qui pourrait consister à tuer les soldats ennemis plutôt que les capturer lorsque cela est possible, le respect du droit international humanitaire à l’égard des prisonniers de guerre, l’arrivée de « combattants étrangers » sur le territoire ukrainien, l’emploi de bombes à sous munitions, la création de couloirs humanitaires et l’hypothèse d’opérations spatiales hostiles.
La semaine qui vient de s’écouler le démontre, loin d’être un tigre de papier, le droit international humanitaire est un droit pragmatique et qui trouve une application concrète, un droit en mesure d’embrasser toutes les hypothèses qui se présentent lors des conflits armés, un droit créé pour limiter autant que faire se peut les effets de la guerre. Un droit dont nous sommes convaincus qu’il faut continuer de porter la voix et qu’il faut éclairer et faire connaître, pour le bénéfice de ceux et celles qui sont affecté-e-s par les conflits armés, en Ukraine et partout dans le monde.
Comme pour la précédente, il est possible de naviguer dans cette note par thématique :
- Capturer plutôt que tuer
- Respect du droit international humanitaire à l’égard des prisonniers de guerre
- « Combattants étrangers »
- Emploi de bombes à sous-munitions
- « Couloirs humanitaires »
- Opérations spatiales hostiles
Le précédents billet est disponible ici : billet 1 (27 février 2022).
D'autres billets publiés après sont disponibles ici : billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1 avril 2022) ; billet 7 (12 avril 2022)
Le 3 mars, il a été rapporté dans un premier temps que tout soldat de l’artillerie russe qui serait capturé par les forces armées ukrainiennes serait tué (par le biais d’un tweet qui a été depuis supprimé), puis (dans un tweet de correction) que les forces armées ukrainiennes ne captureraient plus d’artilleurs russes mais ne les n’épargneront pas « en réponse à leur "bombardement brutal" des civils et des villes ». Quelle que soit l’hypothèse, elle est totalement contraire au droit international humanitaire. Premièrement, tout soldat capturé doit être traité humainement et sa dignité doit être respectée. Ceci est évidemment rappelé par la Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, notamment à son article 13. Ainsi, il ne peut pas être exécuté sur la base de la participation de son corps d’armée à des exactions passées. Si un soldat est soupçonné d’avoir commis des crimes, il peut être poursuivi et jugé. S’il est reconnu coupable, il sera condamné à une peine, laquelle ne devrait pas être la peine de mort. Annoncer vouloir tuer tout soldat russe capturé revient à revendiquer commettre des exécutions extrajudiciaires, lesquelles sont également prohibées dans le champ du droit international des droits humains. Deuxièmement, le droit international humanitaire interdit de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier, ce à quoi peut s’apparenter la déclaration qui aurait été formulée par les forces spéciales ukrainiennes. L’interdiction de déclarer qu’il n'y aura pas de survivants est analogue à l’objectif de l'interdiction de tuer ou de blesser des personnes hors de combat. Lorsqu'un soldat se rend, est blessé ou est incapable de se défendre, quelle qu’en soit la raison, il ne représente plus une menace et il serait donc contraire aux principes fondamentaux du droit international humanitaire de le tuer.
Enfin, ces déclarations invitent également à clarifier qu’il existe un débat en droit international humanitaire quant à savoir s’il serait toujours préférable de capturer plutôt que de tuer. Celui-ci résulte de l’affirmation d’un des plus éminents promoteurs du droit international humanitaire, Jean Pictet, selon qui « [s]i l’on peut mettre un militaire hors de combat en le capturant, il ne faut pas le blesser ; si l’on peut atteindre ce résultat en le blessant, il ne faut pas le tuer. Si, pour le même avantage militaire, on dispose de deux moyens, dont l’un cause de moindres maux, c’est celui-là qu’il faut choisir » (Développement et principes du droit international humanitaire, Genève/Paris, Institut Henry-Dunant, Pédone, 1983, p. 92). Humainement, cette affirmation ne saurait faire l’objet de beaucoup de contestations, mais du point de vue strictement juridique il reste que l’absence d’un « droit » de tuer illimité n’implique pas nécessairement une obligation juridique de capturer plutôt que de tuer. Au-delà de la persistance du débat, on soulignera simplement que même si lors d’affrontements de grande ampleur, tels que ceux qui se déroulent actuellement en Ukraine, il n’est pas toujours possible de capturer plutôt que de tuer, « ce serait bafouer les notions fondamentales d’humanité que de tuer un adversaire ou de ne pas lui donner une chance de se rendre quand il n’existe manifestement aucune nécessité d’employer la force létale » (Guide interprétatif sur la participation directe aux hostilités, p. 84) et que dès lors qu’un soldat, ou toute autre personne quel que soit son statut, se trouve aux mains de l’ennemi, il doit être traité humainement et il ne doit pas être porté atteinte ni à sa dignité, ni à sa vie.
Respect du droit international humanitaire à l’égard des prisonniers de guerre
Il est en revanche également rapporté des exemples de respect des règles de droit international humanitaire applicables aux prisonniers de guerre. En effet, les forces armées ukrainiennes autoriseraient les prisonniers de guerre à appeler leurs familles, qui pourraient ensuite leur rendre visite en Ukraine. Il s’agit là d’une mesure respectueuse de l’article 71 de la Troisième Convention de Genève, selon lequel les prisonniers de guerre doivent être autorisés à correspondre avec leur famille.
De même, Peter Maurer (président du Comité international de la Croix-Rouge), s’est déclaré « positif [nous traduisons] » à propos de la possibilité pour les délégués du Comité international de la Croix-Rouge de rendre visite aux prisonniers de guerre détenus en Ukraine. Il s’agirait de la mise en application de l’article 126 de la Troisième Convention de Genève qui énonce que les délégués du Comité international de la Croix-Rouge « seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre », afin de vérifier que les conditions dans lesquels ils se trouvent sont conformes à la Troisième Convention de Genève relative à leur traitement.
Selon plusieurs médias des combattants venus de l’étranger auraient rejoint l’armée ukrainienne pour prêter main forte face à la Russie. En effet Volodymyr Zelensky a appelé tous les étrangers qui le désiraient à « rejoindre les forces de défenses », créant une unité spéciale : la Légion internationale. Ce phénomène n'est pas nouveau et a déjà été observé en Ukraine par le passé. Il arrive en effet que des personnes étrangères – au sens qu’elles ne sont pas des ressortissantes d’une des parties au conflit – prennent aussi les armes sans répondre notamment à la définition des mercenaires. Ces personnes ont alors été désignées par l’appellation « combattants étrangers », une catégorie qui n’existe pas en droit international humanitaire applicable aux conflits armés internationaux, lequel s’en tient strictement à deux catégories de personnes : les « civils » (protégés par la quatrième Convention de Genève de 1949) et les « combattants » (protégés par la troisième Convention de Genève de 1949). Dans un conflit armé, une personne appartient soit à l’une, soit à l’autre de ces catégories selon sa situation et selon la manière dont elle prend éventuellement part aux hostilités. Devant cette réalité grandissante toutefois, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté en 2014 la résolution 2178 donnant une définition des « combattants étrangers » en lien avec le terrorisme et à la participation aux activités terroristes de personnes venues de différents pays. Cette dénomination est de nature à créer le trouble vis-à-vis des prescriptions du droit international humanitaire.
En effet, en ce qui concerne les combattants dans les conflits armés internationaux, comme c’est le cas actuellement en Ukraine, ceux-ci sont définis comme suit par le droit international humanitaire coutumier tel qu’identifié par le Comité international de la Croix-Rouge : « tous les membres des forces armées d’une partie au conflit sont des combattants, à l’exception du personnel sanitaire et religieux ». La nationalité ne fait pas partie des éléments de la définition. Dès lors que des personnes volontaires prennent part aux hostilités et font partie des forces armées d’une partie au conflit, elles sont considérées comme étant des « combattants » (article 4.A.1 de la Troisième Convention de Genève). De même, si elles ne font pas formellement partie des forces armées, elles peuvent être considérées comme telles si elles appartiennent à une partie au conflit, aux quatre conditions cumulatives suivantes : avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; porter ouvertement les armes ; et se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre (article 4.A.2, voir également les articles 43 et 44 du Protocole additionnel I).
Si les personnes dont il est question ne répondent pas à ces définitions, elles sont alors automatiquement considérées comme des personnes civiles (article 50 du Protocole additionnel I). De plus, elles doivent être considérées comme des « civils protégés » lorsqu’elles se trouvent au pouvoir d’une partie au conflit dont elles ne sont pas ressortissantes (article 4 de la Quatrième Convention de Genève). En contrepartie d’appartenir à la catégorie des personnes civiles, ces dernières doivent alors s’abstenir de participer aux hostilités. Si elles le font néanmoins, elles ne perdent pas leur statut de civil. Cependant, dans un premier temps, elles perdent leurs protections et peuvent faire l’objet d’attaques pendant le temps de leur participation aux hostilités. Deuxièmement, elles peuvent être poursuivies et condamnées pour le simple fait d’avoir pris part aux hostilités, contrairement aux combattants qui ne peuvent pas être poursuivis de ce seul fait, mais peuvent faire l’objet de poursuites notamment s’ils ont commis des violations du droit international humanitaire avant leur capture.
Aux termes du droit international humanitaire, il n’existe pas de catégories intermédiaires. Aussi les personnes qui prennent part aux hostilités, quelles qu’elles soient, se voient attribuer un statut et jouissent des privilèges et des inconvénients affectés à celui-ci. Et indépendamment de toute autre considération, elles doivent être traitées humainement dès lors qu’elles se trouvent aux mains de l’ennemi.
Emploi de bombes à sous-munitions
Dès le début de l’offensive russe, plusieurs organisations non gouvernementales ont fait état de l’utilisation de bombes à sous-munitions. Selon Human Rights Watch, le 24 février 2022 un missile russe contenant une arme à sous-munition aurait frappé une rue en avant d’un hôpital dans la ville de Vuhledar, faisant 4 morts et 10 blessés civils dont certains faisaient partie du personnel de santé. Dans la matinée du 25 février, d’après Amnistie Internationale cette fois, une école maternelle et une crèche, où s’étaient réfugiés des civils, aurait été touchées par des armes à sous-munitions larguées par une roquette russe dans la ville d’Okhtyrka, faisant 3 morts dont un enfant. L’utilisation d’armes à sous-munitions avait déjà été soulevée entre juillet 2014 et février 2015 par Human Rights Watch . L’enquête de l’ONG avait précisé que ces moyens de guerre étaient utilisés dans l’Est de l’Ukraine tant par les forces gouvernementales ukrainiennes que par les groupes armés soutenus par la Russie.
Une bombe à sous-munitions est une arme conçue pour disperser ou libérer de plus petites charges, explosives ou non, pesant moins de 20 kilogrammes et qui ne sont pas guidées (voir la définition posée à l’article 2 de la Convention sur les armes à sous-munitions de 2008). Ces plus petites charges se dispersent alors de manière aléatoire sur une large superficie. Elles sont par ailleurs conçues pour exploser avant, pendant ou après l’impact, ce qui peut laisser des fragments explosifs sur un vaste périmètre, allant de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres. La Convention sur les armes à sous-munitions de 2008 interdit l’utilisation, la production, le transfert et le stockage des armes et bombes à sous-munitions. Elle exige également la destruction des stocks, la dépollution des zones contaminées par les restes non explosés et l’assistance aux victimes.
Bien que ni l’Ukraine ni la Fédération de Russie ne soit partie à cette Convention, qui ne produit dès lors pas d’effets juridiques à leur égard, il convient de rappeler que le droit international humanitaire n’autorise pas les parties à un conflit armé à avoir recours à un choix illimité en ce qui concerne les armes employées. Le droit international humanitaire comprend en effet des règles imposant des restrictions et des obligations relatives à l’emploi de certaines armes. Aussi, pour qu’une arme soit licite elle doit respecter trois règles : la distinction entre les civils et les combattants et entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires ; l’interdiction de causer des maux superflus qui se définit par le fait d’employer des moyens et méthodes de guerre pouvant causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles ; et l’interdiction d’utiliser des armes ayant des effets indiscriminés. Ces règles sont formulées au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), ratifié autant par l’Ukraine que par la Fédération de Russie. Elles ont également une valeur coutumière (voir règles 1, 7, 70 et 71 de l’étude du Comité International de la Croix-Rouge) et doivent à ce titre être respectées par tous les États du monde. L’utilisation de bombes à sous-munitions se trouve donc en contradiction avec ces règles en raison de leur impossibilité de distinguer entre les civils et les combattants, des maux superflus qu’elles pourraient causer et de leurs effets indiscriminés puisque leurs effets ne peuvent être limités.
Enfin, étant rapporté que les bombes à sous-munitions utilisés dans les affrontements en cours auraient touché des écoles et un hôpital, il est essentiel de rappeler que ceux-ci sont des biens de caractère civil par nature et qu’ils sont donc protégés à ce titre. L’article 19 de la Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 dispose en particulier que les établissements de santé « ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques ». Les écoles sont quant à elles protégées contre les attaques au titre de l’article 52 du Protocole additionnel I et en vertu de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles de 2015, approuvée par l’Ukraine, dont le but est de renforcer la protection des écoles dans les conflits armés.
Le 3 mars 2022, à l’issue de pourparlers, les représentant-e-s de la Fédération de Russie et de l’Ukraine ont annoncé s’être entendus sur la mise en place de « couloirs humanitaires » dont le but est de servir à l’évacuation des populations civiles souhaitant fuir les combats, mais aussi à l’acheminement de vivres et de médicaments à destination de la population restée sur place. Cette démarche renvoie à au moins deux aspects du droit international humanitaire qui régit à la fois les contacts non hostiles entre les parties au conflit et l’accès humanitaire.
Concernant les négociations, la règle 66 du droit international humanitaire coutumier tel qu’identifié par le Comité international de la Croix-Rouge prévoit que les parties au conflit peuvent établir entre elles des contacts non hostiles par n’importe quel moyen de communication. Ces contacts peuvent avoir un caractère humanitaire et porter sur un accord des belligérants pour : évacuer la population civile, la création de zone protégées ou le passage du personnel sanitaire ou religieux par exemple. Les négociations entre Kiev et Moscou s’inscrivent donc tout à fait dans cette règle. Il est par ailleurs notable que le droit précise que ces contacts et négociations doivent être fondés sur la bonne foi. C’est-à-dire que les accords conclus doivent être respectés. Aucune des parties au conflit ne pourrait se servir de ces couloirs humanitaires à des fins militaires. Parallèlement, ceux-ci, en raison de leur caractère civil, sanitaire et humanitaire, ne pourraient pas non plus faire l’objet d’attaque. Si les parties venaient à violer leur engagement. Cela serait constitutif de « tromperie illicite ».
Concernant l’accès humanitaire, celui-ci est résumé par la règle 55 du DIH coutumier. Selon cette règle, les parties au conflit doivent accorder le libre passage de tout secours humanitaire destiné aux personnes civiles. Les parties doivent consentir à ce que des actions se secours se déroulent sur leur territoire. Toutefois, si les actions de secours sont de caractère humanitaires et impartiales, elles ne peuvent refuser de donner leur consentement lorsque la population civile dépend de l’aide humanitaire pour sa survie. La population civile a le droit de recevoir cette aide. Le corolaire à ce droit est la protection du personnel et des biens utilisés pour les opérations de secours. Ce personnel et ces biens sont protégés contre les attaques. Ainsi, la population civile, et en particulier celle qui se trouve dans les zones assiégées ou contrôlées par l’ennemi, a le droit de recevoir de l’aide humanitaire, et l’accès à cette population par les couloirs humanitaires ne peut être empêché, retardé, ou entravé.
Le prolongement d’un conflit armé dans le domaine spatial n’est plus une hypothèse doctrinale. À cet égard, les décisions prises par la Fédération de Russie de stopper le placement en orbite de satellites de télécommunication via son lanceur Soyouz et de rapatrier le personnel russe présent sur la base de lancement de Kourou en Guyane française viennent compromettre une coopération internationale spatiale entre plusieurs nations. La Fédération de Russie a également décidé de ne plus fournir de service de maintien à poste pour la Station internationale spatiale (ISS), ce qui a un impact direct sur la conduite des missions au sein de celle-ci. Cela pourrait aller dans le sens de la menace proférée par le Directeur de l’agence spatiale russe Roscosmos sur son compte Twitter, de désorbiter cette station. Cette opération, en plus de créer un nombre incalculable de débris spatiaux et par conséquent des armes spatiales par destination, viendrait se « crasher », selon son expression, sur les continents européen ou américain. Menace rendue crédible par le tir antisatellite russe du 15 novembre 2021, témoignant de la capacité de frappe russe dans l’espace extra-atmosphérique. Si ces opérations sont avérées, cela donnerait alors l’impression d’une sorte de « siège spatial » tenu par les russes contre le reste du monde, en position de spatio-dépendance puisque « le milieu spatial irrigue de manière déterminante l’ensemble des activités humaines, […] pour répondre [aux besoins] sociétaux essentiels, voire vitaux, [la destruction de satellites empêcherait d’anticiper] des risques naturels, climatiques et environnementaux [et de prévoir la mise en place de systèmes] d’aide aux populations en détresse, de surveillance des frontières et de défense ».
Dans ce contexte, la question de la création d’un statut protecteur des satellites en temps de guerre se pose avec encore davantage d’acuité. Un tel statut pourrait être envisagé à la lumière de la protection offerte par l’article 52 du Protocole additionnel I de 1977, pour les biens de caractère civil, et/ou de celle offerte pour la protection des biens indispensables à la survie de la population civile prévue par l’article 54, et/ou de celle offerte à l’environnement naturel par l’article 55 du même Protocole, voire de celle offerte aux ouvrages et installations contenant des forces dangereuses prévue par l’article 56 (même si ici les satellites sont plutôt utilisés comme garants d’autres biens sur terre contenant ces dites forces, tels qu’une centrale nucléaire). Une mise en place d’un « siège spatial » autour de ces installations vitales, accompagné d’opérations spatiales hostiles par une partie au conflit, pourrait ainsi se trouver en contradiction avec le droit international humanitaire, au titre des règles susmentionnées.
En outre, bien qu’à ce stade la situation relève du domaine de la dissuasion, si les menaces russes étaient mises à exécution, la possibilité même de respecter les règles fondamentales du droit international humanitaire lors d’opérations spatiales hostiles dans l’espace extra-atmosphérique semble difficile à vérifier, compte tenu des particularités géographiques de ce milieu et de la mécanique spatiale. En effet, les notions de temps et d’espace, différentes par rapport à celles qui existent sur terre, en mer et dans les airs, conduisent à une quasi-impossibilité de vérifier le respect des règles relatives à la distinction, la proportionnalité, les précautions, l’interdiction des maux superflus et de souffrances inutiles dans la conduite d’hostilités.
Ce billet ne lie que la ou les personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de Osons le DIH!, de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale et les droits fondamentaux, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.
La publication de ce billet est en partie financée par Osons le DIH! et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.